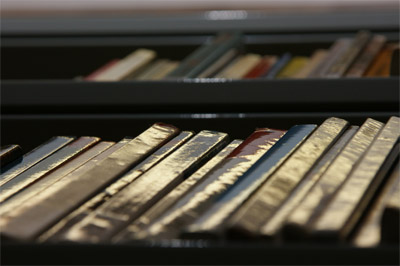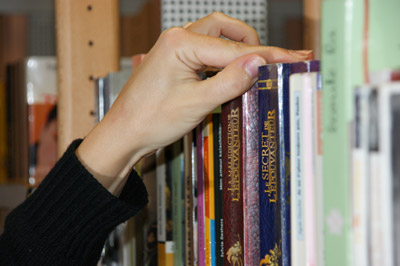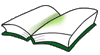BibliothĆØque de l'Ecole Nationale SupĆ©rieure des Travaux Publics - Francis Jeanson "BENSTP-FJ"
Auteur D. Chevallier
Documents disponibles écrits par cet auteur (5)


 Interroger des sources externes
Interroger des sources externes
ThĆ©orie des distributions. #Vol.1#, ElĆ©ments de la thĆ©orie des espaces vectoriels topologiques [texte imprimĆ©] / D. Chevallier ; J.J. Freid, Auteur . - Paris : ENPC, 1973-1974 . - 136 p. ; 30 cm. Langues : FranƧais ( fre) |  |
Exemplaires(0)
ThĆ©orie des distributions. #Vol.2#, DĆ©finition des distributions et opĆ©rations sur les distributions [texte imprimĆ©] / D. Chevallier ; J.J. Freid, Auteur . - [Paris] : ENPC, 1973-1974 . - 136 p. ; 30 cm. Langues : FranƧais ( fre) |  |
Exemplaires(0)


[article]
| Titre : |
ThƩorie hilbertienne des structures : amortissements et flexibilitƩ rƩsiduelle en dimension infinie |
| Type de document : |
texte imprimƩ |
| Auteurs : |
D. Chevallier, Auteur |
| AnnƩe de publication : |
1987 |
| Article en page(s) : |
pp. 3-25 |
| Langues : |
FranƧais (fre) |
| RƩsumƩ : |
La gĆ©omĆ©trie hilbertienne de dimension infinie est le cadre mathĆ©matique naturel de la dynamique linĆ©aire des structures que l'on expose ici d'une faƧon synthĆ©tique en faisant ressortir des propriĆ©tĆ©s de caractĆØre topologique spĆ©cifiques de ce contexte. Celles-ci sont masquĆ©es par les approximations a priori, couramment pratiquĆ©es, rĆ©duisant les problĆØmes de structure Ć des problĆØmes de dimension finie (description de la structure par un nombre fini de paramĆØtres). L'on examine ainsi les propriĆ©tĆ©s topologiques de l'hypothĆØse de Basile schĆ©matisant les amortissements et celles de l'opĆ©rateur de flexibilitĆ© dynamique en analyse modale. L'Ć©tude fait ressortir le rĆ´le essentiel du choix des espaces fonctionnels et de leurs topologies ainsi que du comportement asymptotique de la suite des facteurs d'amortissement į¶‹n dans les approximations par troncature modale et dans la thĆ©orie de la flexibilitĆ© rĆ©siduelle dont la forme usuelle n'est valable que si į¶‹n = O(Ļ‰n). |
in Annales des ponts et chaussƩes > 41 (Janvier 1987) . - pp. 3-25
[article] ThƩorie hilbertienne des structures : amortissements et flexibilitƩ rƩsiduelle en dimension infinie [texte imprimƩ] / D. Chevallier, Auteur . - 1987 . - pp. 3-25. Langues : FranƧais ( fre) in Annales des ponts et chaussƩes > 41 (Janvier 1987) . - pp. 3-25
| RƩsumƩ : |
La gĆ©omĆ©trie hilbertienne de dimension infinie est le cadre mathĆ©matique naturel de la dynamique linĆ©aire des structures que l'on expose ici d'une faƧon synthĆ©tique en faisant ressortir des propriĆ©tĆ©s de caractĆØre topologique spĆ©cifiques de ce contexte. Celles-ci sont masquĆ©es par les approximations a priori, couramment pratiquĆ©es, rĆ©duisant les problĆØmes de structure Ć des problĆØmes de dimension finie (description de la structure par un nombre fini de paramĆØtres). L'on examine ainsi les propriĆ©tĆ©s topologiques de l'hypothĆØse de Basile schĆ©matisant les amortissements et celles de l'opĆ©rateur de flexibilitĆ© dynamique en analyse modale. L'Ć©tude fait ressortir le rĆ´le essentiel du choix des espaces fonctionnels et de leurs topologies ainsi que du comportement asymptotique de la suite des facteurs d'amortissement į¶‹n dans les approximations par troncature modale et dans la thĆ©orie de la flexibilitĆ© rĆ©siduelle dont la forme usuelle n'est valable que si į¶‹n = O(Ļ‰n). |
|  |


[article]
| Titre : |
ThƩorie hilbertienne des structures (suite). FlexibilitƩs et inerties rƩsiduelles des structures amorties |
| Type de document : |
texte imprimƩ |
| Auteurs : |
D. Chevallier, Auteur |
| AnnƩe de publication : |
1988 |
| Article en page(s) : |
pp. 3-19 |
| Langues : |
FranƧais (fre) |
| RƩsumƩ : |
Cet article fait suite et complĆØte une prĆ©cĆ©dente publication parue dans cette revue et concerne l'application de la gĆ©omĆ©trie hilbertienne Ć l'Ć©tude des vibrations des structures fortement amorties. L'amortissement est introduit dans le cadre de l'hypothĆØse de Basile mais les coefficients d'amortissement modaux sont ici quelconques. L'on Ć©tablit d'abord des propriĆ©tĆ©s de rĆ©gularitĆ© de la flexibilitĆ© dynamique (thĆ©orĆØme 1.2) puis des rĆ©sultats prĆ©cis quant Ć la vitesse de convergence des approximations de la rĆ©ponse de la structure par troncature modale et calculĆ©es Ć l'aide des flexibilitĆ©s rĆ©siduelles proposĆ©es Ć la fin du premier article pour les structures amorties. L'on Ć©tudie ensuite les vibrations d'une structure excitĆ©e par mise en mouvement de ses appuis; le calcul, avec troncatures modales, de la rĆ©ponse de la structure et des efforts engendrĆ©s au niveau des appuis conduit au concept d'inertie rĆ©siduelle. La dĆ©finition adoptĆ©e ici diffĆØre de celle prĆ©cĆ©demment proposĆ©e et semble plus, performante. Le thĆ©orĆØme 2.1 prĆ©cise la vitesse de convergence et l'efficacitĆ© du procĆ©dĆ© d'accĆ©lĆ©ration de convergence qui en dĆ©coule. |
in Annales des ponts et chaussƩes > 48 (Octobre 1988) . - pp. 3-19
[article] ThƩorie hilbertienne des structures (suite). FlexibilitƩs et inerties rƩsiduelles des structures amorties [texte imprimƩ] / D. Chevallier, Auteur . - 1988 . - pp. 3-19. Langues : FranƧais ( fre) in Annales des ponts et chaussƩes > 48 (Octobre 1988) . - pp. 3-19
| RƩsumƩ : |
Cet article fait suite et complĆØte une prĆ©cĆ©dente publication parue dans cette revue et concerne l'application de la gĆ©omĆ©trie hilbertienne Ć l'Ć©tude des vibrations des structures fortement amorties. L'amortissement est introduit dans le cadre de l'hypothĆØse de Basile mais les coefficients d'amortissement modaux sont ici quelconques. L'on Ć©tablit d'abord des propriĆ©tĆ©s de rĆ©gularitĆ© de la flexibilitĆ© dynamique (thĆ©orĆØme 1.2) puis des rĆ©sultats prĆ©cis quant Ć la vitesse de convergence des approximations de la rĆ©ponse de la structure par troncature modale et calculĆ©es Ć l'aide des flexibilitĆ©s rĆ©siduelles proposĆ©es Ć la fin du premier article pour les structures amorties. L'on Ć©tudie ensuite les vibrations d'une structure excitĆ©e par mise en mouvement de ses appuis; le calcul, avec troncatures modales, de la rĆ©ponse de la structure et des efforts engendrĆ©s au niveau des appuis conduit au concept d'inertie rĆ©siduelle. La dĆ©finition adoptĆ©e ici diffĆØre de celle prĆ©cĆ©demment proposĆ©e et semble plus, performante. Le thĆ©orĆØme 2.1 prĆ©cise la vitesse de convergence et l'efficacitĆ© du procĆ©dĆ© d'accĆ©lĆ©ration de convergence qui en dĆ©coule. |
|  |


 Interroger des sources externes
Interroger des sources externesLa formation des Ʃquations de la dynamique : examen des diverses mƩthodes / D. Chevallier in Annales des ponts et chaussƩes, 29 (Janvier 1984)
ThƩorie des distributions. #Vol.1#, ElƩments de la thƩorie des espaces vectoriels topologiques / D. Chevallier

ThƩorie des distributions. #Vol.2#, DƩfinition des distributions et opƩrations sur les distributions / D. Chevallier

ThƩorie hilbertienne des structures / D. Chevallier in Annales des ponts et chaussƩes, 41 (Janvier 1987)
ThƩorie hilbertienne des structures (suite). FlexibilitƩs et inerties rƩsiduelles des structures amorties / D. Chevallier in Annales des ponts et chaussƩes, 48 (Octobre 1988)